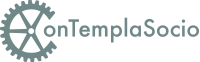Redistribution géographique et ville durable : De Détroit à l’hexagone, des villes se recyclent.
Auparavant, à Détroit, le prix des maisons était de 50 000 dollars environ. Avec la désertion des quartiers à l’abandon, une maison y coûte actuellement 10 dollars ! Certains blogs rapportent, fin 2012, que le centre de Detroit est vide : il n’y a presque personne aux heures de pointe, en totale opposition avec sa voisine ultra active, Chicago. Dans ce centre-ville, on trouve aussi des entrées d’immeubles condamnées et une autoroute presque vide (la fréquentation est habituellement très dense sur les autoroutes américaines). Ce constat attire des agents immobiliers qui y voient un potentiel énorme de réinvestissement, d’autant plus que l’architecture n’implique pas de surcoût. Une réhabilitation luxueuse se dessine, dans une logique de gentrification.1
Décembre 2012. Un bâtiment en plein centre-ville, à vendre ou à louer, et ce depuis plusieurs années… © la goutte au nez, blog
Le Wurlitzer Building. Le bâtiment a finalement été vendu à un promoteur New-Yorkais en 2015 pour 1,4 million de dollars. © Blog des Tendances
Les populations qui pensaient que l’élection d’un maire afro-américain allait changer les choses2 ont constaté que l’explication culturelle ne pouvait tout résoudre sans prendre en considération le facteur économique. L’ethno-géographie3 peut nous aider à comprendre des trajectoires d’engagement qui redessinent relativement l’économie d’un territoire. On décide, par exemple, de faire les choses par soi-même, en communauté : Do It Ourselves. Sur le terrain, une multitude de nouvelles start-ups fleurissent et réinvestissent la ville par le biais des nouvelles technologies, dont la société Détroit Labs4 qui promeut des emplois moins dépendants des anciennes « Big Three ». C’est bien sur le papier, en revanche en grattant davantage, on aperçoit une dissociation entre deux types d’acteurs qui s’engagent à se réapproprier la ville de façon optimiste entre l’avenue Woodward et le River Rouge Plant :
-
Les « pionniers urbains » qui souhaitent échapper à l’image du passé fou et menteur, en tant qu’idéaliste intellectuel ou cadre ultra-rationnel. Leurs idées technologiques, amenées et pensées, réhabilitent l’espace et donnent de nouvelles opportunités à la « ceinture de rouille »5. Ils viennent souvent de New-York ou San-Francisco.
-
Des militants plus engagés et natifs se réclamant d’eux même. Ils misent sur le « système D » et s’organisent pour la production de nourriture et des travaux de réparation en tout genre, allant même jusqu’à la production d’énergie pour le domicile6. Des qualités importantes pour survivre dans une ville en transition, passionnante et prometteuse.
Y a-t-il un véritable échange entre ces deux parties ? Un avenir plus prometteur et une véritable renaissance ?
Le mot renaissance est très brumeux, il n’indique rien de précis. C’est peut-être, juste une façade qui ne remet pas en cause la fausseté d’une certaine gestion politique d’une ville qui est souvent nourrie par une certaine bourgeoisie désormais « mondialisée », « flexible et connectée », qui travaille dur et souhaite que le restaurant vienne à eux parce qu’ils n’ont plus le temps d’y aller. Ces néo-petits bourgeois que le sociologue Jean Pierre Garnier appelle la PBI (Petite Bourgeoisie intellectuelle7) est de facto une alliée des classes dominantes sur des thèmes plus sociétaux et moins stricto sensu sur des questions « sociales »8. On remarque qu’il n’y a pas ou presque pas de contestation sur des questions sociales d’ordre plus « organiciste », mais davantage d’ordre « d’épanouissement individuel » avec une teinte émotionnelle exacerbée (comment tu ressens les choses, comment tu les gères) … ou « rebelle de confort » selon l’écrivain Philippe Muray. On observe alors, d’un côté, des espaces « requalifiés », réservés aux gens de qualité et de l’autre ceux de la périphérie avec des couches populaires plus reléguées. Jean-Pierre Garnier est convaincu que la vraie violence urbaine est cette gentrification masquée qui cherche à coloniser les quartiers populaires – au-delà des « stars-architectes », mondialement reconnus et bâtissant au service du marketing urbain, les métropoles du capitalisme mondialisé – avec la mise en place d’une novlangue exerçant une violence symbolique. Celle-ci ne faisant que redoubler celle, bien réelle, qui s’exerce déjà sur les dépossédés du droit à la ville, plus nombreux que jamais. Des architectes comme Franco la Cecla, pensant que le renouvellement urbain aide à repenser un nouveau cadre de vie qui détermine alors un nouveau mode de vie »9. Cette idée encore très répandue comme allant de soi, est obsolète. J-P. Garnier en reprenant le célèbre sociologue, Henri Lefebvre :
« D’une manière plus générale, il est illusoire de croire qu’il suffit de « changer la ville pour changer la vie » sans chercher à changer la société sinon de société. »
La gentrification participe à une reconquête urbaine, c’est un terme très fort qui désigne de ce fait une « guerre civile non dite » et que cela, sans chercher trop loin, se traduit tout simplement et souvent par une réhabilitation des anciens quartiers populaires ; à quel prix ? Ils sont souvent réservés par la suite à des gens de qualité, connectés et innovateurs – « cette colonisation par les « bobos » va de pair avec l’expulsion des « prolos » résume J-P. Garnier – et ces villes outre-Atlantique subissent souvent des « apartheids urbains » pour préserver un tant soit peu un « lien social », ce qui est vraiment efficient dans les « villes globales » de Saskia Sassen.
Est-ce que les nouveaux pionniers participent à la mise en lumière d’un nouvel espace public d’« événements » festivo-culturels (dans le règne du publicitaire et du sécuritaire) programmés par les autorités et sponsorisés par les marchands ? Ce qui crée souvent une dualité entre les gens ordinaires, producteurs d’économie réelle et évoluant comme ils le peuvent avec des citadins de seconde voire de troisième zone et que le premier schéma tente de cacher, de faire sortir par cette « apparence caricaturale d’appropriation de l’espace » que cite Henri Lefebvre.10
Le capitalisme néo-libéral a cette force de récupérer, de recycler et d’orienter ce qui est en contradiction avec son propre système, pour que « tout » devienne marché. Comme l’écologie était une idéologie anti-marché elle est devenue une écologie de marché avec le film d’Al Gore qui est en quelque sorte l’élément déclencheur.
Dans le cas français, l’opposition est géographique et socio-économique, il commence à s’y dessiner clairement une fracture sociale et spatiale11, qui s’illustre par la montée simultanée de la précarité et de la très haute bourgeoisie. Une polarisation sociale qui a une dimension géographique. En somme, pour Christophe Guilluy, la France se dirige dangereusement vers ce schéma : Paris et une douzaine de métropoles régionales qui représentent 40 % de la population et un « territoire périphérique » de 60 % avec des territoires périurbains, des villes moyennes et des espaces ruraux où les fragilités sociales touchent des paysans, des ouvriers, des employés et des petits fonctionnaires avec des bassins d’emplois moins dynamiques et également, une offre de soins moins équilibrée avec des médecins en sous-effectifs dans certaines agglomérations. La mondialisation bénéficie essentiellement aux métropoles, ce phénomène se traduit par les « villes globales » et leurs hubs particuliers, développés par Saskia Sassen. Oui, dans les métropoles elles-mêmes, il y a d’énormes contrastes, mais cela reste régulé par un certain dynamisme économique (les secteurs tertiaire et de l’information, couplés aux échanges internationaux, ont des retombées positives) supérieur, qui peaufine d’une certaine façon ces métropoles, surtout par la cohabitation de l’entre soi résidentiel et scolaire 12 et l’aspect ethnique et familial créant de surcroit un « Lumpenprolétariat », très utile et docile aux dominants. La géographie injuste est induite par les désordres de la mondialisation : délocalisation – et défiscalisation de gros groupes au détriment des PME et de l’artisanat qui paye leurs impôts – insécurité sociale et surtout culturelle. Les emplois de la mondialisation, les plus rémunérateurs, sont concentrés dans les métropoles ; cette demande de vouloir davantage de protections contre la violence de la concurrence internationale économique peut se voir alors comme un véritable mouvement populaire face à la mondialisation, qui n’est pas forcément à relier à des théories maurassiennes ou fascistes. Un mouvement effectivement « populiste », un tant soit peu souverainiste et localiste, qui n’est pas spécialement à confondre avec le populisme poujadiste des années 30 que targue tant Manuel Valls, terme devenu péjoratif, ce qui est une réaction normale contre des élites trop mondialisées et déconnectées. Cette analyse de Christophe Guilluy 13 peut éclairer sur les logiques électorales en superposant la géographie et le social. En parallèle, d’importantes lignes de fractures sont encore très marquantes et même renforcées entre les Etats progressistes et conservateurs14, entre yankees et confédérés aux États-Unis sur le rôle de l’Etat et sa régulation. Des Etats comme le Vermont, qui encourage à une certaine excentricité par rapport aux mœurs sociétales, une ville comme Détroit reliée à Cleveland et à Pittsburgh, aussi portés sur l’agriculture urbaine que Dallas au Texas ou Denver au Colorado le sont sur l’extraction du gaz de schiste.
La ville durable est un artefact, elle devient une base avancée pour un certain capitalisme15 plus flexible, mais qui bien déguisé peut revenir sur les acquis sociaux. Les transformations produites par le système capitaliste actuel avec la Transnationalisation (terme plus exact pour désigner la mondialisation) du capitalisme dans l’urbain évoluent avec trois idéologies en évolution : l’individualisme développé avec la bourgeoisie du XVIIIe ; le consumérisme (omniprésent partout) ; et enfin, arrivé plus tard avec le développement durable, le citoyennisme (respecter toutes les normes et les codes imposés par l’état), un moyen pour le pouvoir exécutif de faire le plein de ses exécutants en mettant en œuvre les normes et les codes par les pouvoirs et tout cela de façon individualiste.
La campagne Europe-Ecologies les verts pour les élections régionales de 2015.
L’idéologie de l’écologisme est en fait très consensuelle. Le vocabulaire devient propagande entre durable qui devient vite responsable. Il y a des éco-gestes et des éco-actes, de Paris en passant par Nantes et Dijon. C’est une homogénéisation du « techno métropolitain vert » et dont les forces vives sont des ingénieurs, des cadres, des chefs de labo : c’est la « classe créative » de Richard Florida que cite Jean Pierre Garnier. Ces porteurs d’innovation sont importants pour que la ville devienne compétitive et que la concurrence reste libre et non faussée, restant un principe cardinal qui régit la vie en société entre individus habitant toujours plus les villes. Une « bonne ville » est celle qui est la plus innovante, compétitive et où l’on sait allier la science et la technique. Ces villes peuvent développer des hautes technologies, celles-ci sont actives à haute qualification avec un équipement haut de gamme, enrobé par le label « haute qualité environnementale ».
Justement, qu’est-ce qui se cache derrière ce front écologique ? Et comment le capitalisme peut-il le récupérer ? Effectivement, l’écologie avant les années 1975 avait un véritable visage anticapitaliste. Le visage à bien changé et beaucoup d’écologistes actuels ne remettent plus en cause le capitalisme et sa novlangue néo-libérale comme système de croissance limité de flux tendus décorés de technosciences invasives et immédiates, qui favorisent la démesure et son action déréglées sur la nature et les hommes. Ils veulent un certain capitalisme adapté qui soit durable, pour un environnement durable – comme certains partis politiques parlent d’une autre Europe – comment le sauver, en sauvant la planète ? De nouveaux marchés pour Bouygues, GDF Suez et la fabrication polluante des panneaux voltaïque (l’extraction du silicium) et les éoliennes « la compagnie du vent » d’une durée de vie de 25 ans, posant la question de fond sur la chaine de complexification de gadgets : à chaque fois qu’on augmente les possibilités énergétiques, la consommation d’énergie augmente, c’est ainsi une logique sans fin. Ainsi cette croissance voulue par une écologie juste globale, n’est pas durable ; une véritable écologie voulue et assumée se pense localement en dialoguant, pour amener en premier lieu des questions éthiques sur une écologie intégrale, « en réconciliant l’humanisme et l’environnementalisme, à faire la synthèse entre respect absolu de la dignité humaine et préservation de la biodiversité »16. M. Bernard Collon du groupe Laffarge nous le dit avec ces mots : il faut réconcilier environnement et croissance et faire de l’environnement un facteur de croissance ! Cela est dit, l’écologie ne doit pas être l’ennemi de la croissance. Un certain système qui dévoie souvent les initiatives populaires, pour les tourner à son avantage.
Pour finir et revenir sur ces villes en recyclages, l’idée de séparation à l’œuvre en décrivant la tripartition de la ville17 qui se caractérise par un « entre-soi » vécu et assumé, n’est pas aussi simple, sauf si on évoque une mode ou une tendance généralisée de réinvestissement parcellaire : du « Do It Yourself »18 au « Do It Ourselves »19. C’est le moment pour certains de récupérer leur ville quand d’autres continuent à l’abandonner. Un habitant de Détroit nous dit : « Il s’agit de dépoussiérer l’or déjà sur place et il pourra briller ». James Howard Kunstler20 fait l’éloge de l’inefficience, prenant comme modèle la nature : celle-ci est fertile quand il y a de la biodiversité, la nature est inefficace de par sa nature, mais dès qu’on veut la rendre efficace par la production, c’est l’épuisement des sols, l’érosion, etc. Il nous dit : « l’efficience est la route la plus rapide pour l’enfer ». Par cette trajectoire, il faut apprendre la suffisance en étant satisfait d’assez et d’avoir ce dont on a besoin, et de ne pas vouloir ce dont nous n’avons pas besoin.